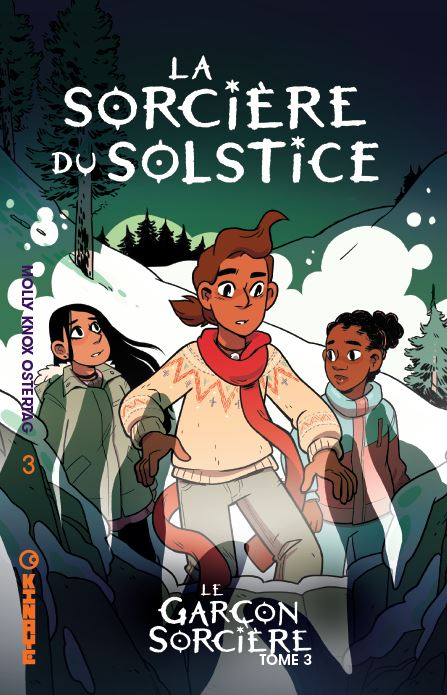Melaine est une jeune fille dont la vie n’est pas remplie de bonheur… elle a déjà perdu ses parents et son grand-père. Il ne lui restait que sa grand-mère, jusqu’au jour où cette dernière meurt. Elle est recueillie par des cousines éloignés avec qui elle vit plein d’aventures et découvre l’existence d’une petite fille sur une photo avec le même médaillon que celui dont elle a hérité… Est-ce un hasard ou le destin ? Qui est cette jeune fille sur la photo ?
Avril ayant été synonyme d’une petite panne de lecture, j’ai dégainé mon arme ultime dans ce genre de cas : la relecture d’un livre aimé. Et donc j’ai ressorti ce roman de Moka, une autrice qui a marqué mon adolescence ! Je me souvenais avoir bien aimé ce roman, mais j’en avais au final très peu de souvenirs précis (hormis le fait qu’il y avait un personnage narcoleptique, mais c’est probablement parce que c’est là que j’ai appris ce mot !).
Le roman est assez court et centré sur un secret de famille. Mélaine, la jeune protagoniste, est recueillie par deux petites cousines au décès de sa grand-mère. Celle-ci l’a désignée comme légataire universelle de tous ses biens, ce qui entraîne une forte dispute entre les membres de la famille qui avaient vu sur son patrimoine : on parle quand même d’une maison, d’un potentiel manoir, de tout le mobilier qui va avec et de bijoux fabuleux. Outre cette bisbille, Mélaine met rapidement le doigt sur une affaire louche et qui va l’obséder : lorsque sa grand-mère était enfant, sa petite sœur chérie, Mélanie, a disparu.
J’aime beaucoup ce court récit car il mélange l’enquête de Mélaine, la recherche dans le passé de sa famille, et sa vie loufoque chez les deux petites vieilles, Heidi et Gretchen. Celles-ci la sortent de l’école (sans trop en parler au juge des tutelles), lui apprennent la photo et un tas d’autres trucs très utiles (mais hors programmes scolaires). Après la vie difficile et triste que Mélaine a vécue chez sa grand-mère (un personnage assez dur), subitement elle trouve de la joie de vivre, de la bienveillance et un environnement chaleureux. Il y a un côté très enthousiaste dans ce récit, avec des petites touches d’humour, notamment parce que Gretchen a tendance à tomber en catalepsie aux pires moments, ce qui est souvent assez drôle (même si parfois la situation devient très tendue). De fait, j’ai trouvé l’ensemble (à nouveau) très plaisant.
Mais ce n’est pas pour autant un récit de bisounours, loin de là. Au fil de ses recherches et des questions qu’elle pose à ses tutrices, Mélaine découvre la vérité sur le passé de sa grand-mère, une petite fille intelligente et maltraitée par son père (on parle de sévices corporels et de maltraitance psychologique graves). Le récit oscille donc sans arrêt entre une part lumineuse et une autre part nettement plus sombre. Si les sévices subis par la grand-mère dans son enfance sont décrits sans pathos, ils ne sont pas non plus édulcorés.
L’intrigue présente aussi une ambiance fantastique légère. En effet, une rumeur court autour de la disparition de Mélanie : son fantôme hanterait la maison familiale, et l’autrice joue parfaitement sur cette ambiance jusqu’à la fin. J’ai trouvé le mélange entre l’aspect fantastique, les découvertes terribles de Mélaine, et sa vie haute en couleur chez Heidi et Gretchen aussi équilibré que réussi.
Au final, le roman est assez court, mais les péripéties s’enchaînent à bon rythme, tout en ménageant des instants plus calmes. C’était vraiment une lecture extrêmement plaisante !
J’ai lu beaucoup de romans de Moka dans mon adolescence et j’avais celui-ci en tête comme étant un de mes favoris. Et la relecture a confirmé cette impression ! Le récit, quoique bref, est très prenant, parfaitement équilibré entre fantastique et recherche dans les secrets de famille. Le ton oscille sans cesse entre humour joyeux et considérations plus graves, à nouveau dans un mélange très réussi. Bref : coup de cœur confirmé !