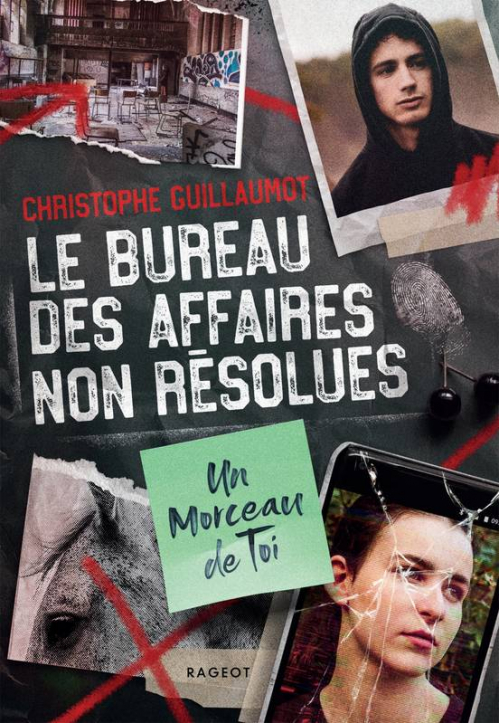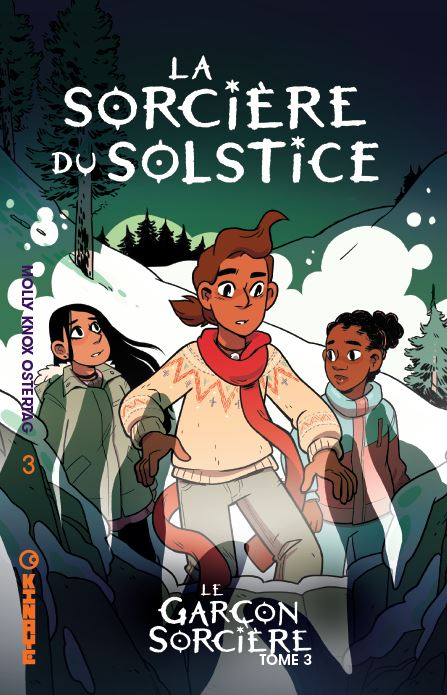Kurara n’a jamais connu d’autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Un jour, pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perdent la raison et sèment la destruction au sein de l’empire. Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n’est pas le cas de son meilleur ami, Haru, grièvement blessé. Sa survie, elle ne la doit qu’à Himura. Pliomage comme elle – quoique plus bourru dans son genre –, il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et a choisi de mettre ses talents au service d’un équipage de chasseurs de shikigami. Un nouveau chapitre s’ouvre alors dans la vie de l’adolescente. Désormais passagère de l’Orihime, la voilà partie pour écumer le ciel, direction la cité céleste de Sola-Il. Son objectif ? Implorer l’aide de la princesse Tsukimi, seule capable de soigner Haru, son compagnon de toujours. Mais pour que cette dernière accepte de la recevoir, il va lui falloir devenir la meilleure pliomage de tout l’empire – rien que ça…
Le titre de cette saga m’intriguait franchement et j’ai été plus que ravie de ma découverte !
L’autrice nous entraîne dans un univers d’inspiration asiatique qui m’a clairement fait penser aux films d’animation d’un célèbre studio japonais, sans doute parce que l’autrice glisse ça et là des descriptions hyper visuelles et détaillées (sans toutefois s’étaler sur dix pages !). De fait, l’immersion dans le roman a été rapide et complète, tant l’univers se révèle saisissant. Il faut dire que le mélange entre empire asiatique, cités flottantes, orques-cumulus cachés dans les cieux, et vaisseaux pirates volants luttant contre des origamis maléfiques a de quoi fasciner !
D’ailleurs, le second point qui m’a hautement emballée, c’est le système de magie qu’elle déploie dans son roman. Les pliomages, dont font partie Kurara et Himura, manipulent en effet le papier. Ils créent à la volée de complexes origamis, objets ou animaux, qu’ils sont en capacité d’animer selon leur volonté. Ceux-ci ne sont pas de « simples » créations, notamment les origamis animaliers, puisqu’ils sont capables de s’exprimer, de raisonner ou d’avoir des émotions (dans une certaine mesure) – ce qui permet à leurs maîtres de se les attacher, à la manière d’animaux serviteurs. Ce qui est intéressant, c’est que la nuance est fine entre les différentes shikigamis : ceux qui ont encore un maître pliomage sont sensés, tandis que les plus âgés, ou ceux dépourvus de maîtres, ayant perdu la raison, deviennent des créatures sanguinaires – que chassent Himura et ses compagnons, à l’instar d’autres équipages. On oscille donc toujours entre émerveillement et danger concernant ces créatures, ce qui instaure pas mal de tensions, notamment lorsque Kurara, qui n’a aucun souvenir de son enfance, fait des découvertes assez fracassantes sur son passé et son histoire, qui vont remettre en question tout ce qu’elle pensait savoir sur la pliomagie – et nous avec.
J’ai trouvé le récit particulièrement prenant et ce pour différentes raisons. L’intrigue est essentiellement centrée sur Kurara. Quelques chapitres intitulés « Interlude » vont toutefois nous amener sur les traces d’une bande de rebelles, le Sohma, qui espère pourvoir remettre les Sorabitos, le peuple traditionnellement versé dans l’art de la navigation aérienne, au centre – alors que l’empire qui les a colonisé les force à cohabiter avec les simples terriens. Plus l’on avance dans le récit, plus les actions du Sohma viennent impacter le fil narratif consacré à Kurara, sans que la jeune fille en ait conscience, ou que les deux arcs narratifs se rejoignent totalement (ce à quoi je m’attendais, tant c’est la configuration classique dans ce genre de cas). Ces deux arcs parallèles, dont l’un semble mineur par rapport à l’autre dans un premier temps, s’entrecroisent d’une façon qui fait parfaitement monter la tension au fil du récit ! Celle-ci est également assurée par les révélations que dissémine l’autrice sur les intentions des uns et des autres.
Certes, l’intrigue suit le fil assez classique du récit d’apprentissage mais on ne tarde pas à découvrir que tous les acteurs n’ont pas exactement les mêmes objectifs. Ainsi, si Himura a pu sauver Kurara au début du récit, c’est bien parce qu’il était chargé de la ramener sur l’Orihime, ce dont la jeune fille n’a pas conscience – alors que les lecteurs, si. Plus l’intrigue avance, plus les révélations de ce type s’accumulent, montrant les divergences d’objectifs chez les différents personnages, voire la façon dont ces objectifs peuvent entrer en conflit. Le fait que ces conflits soient révélés uniquement aux lecteurs par le narrateur omniscient rend le récit particulièrement prenant, et m’a donné très envie de lire rapidement la suite (qui vient tout juste de sortir en version originale).
A ces révélations bien menées s’ajoutent la plume fluide de l’autrice, tant dans les scènes d’actions que dans les passages descriptifs (que j’ai trouvés super bien menés). Et, cerise sur le gâteau, contrairement à la majeure partie de la production fantasy destinée aux adolescents du moment, il n’y a ici pas de romance. Je répète, pas de romance à l’horizon ! Et c’était très bien ainsi ! A la place, l’autrice décrit une très belle relation d’amitié entre Kurara et Haru, son ami de toujours, malheureusement stoppée brutalement suite à l’attaque du Midori. Au final, c’est cette amitié qui motive Kurara, puisque c’est pour sauver son ami qu’elle va tâcher de devenir la pliomage qui surprendra la princesse Tsukimi. Cela change agréablement de ce que l’on a l’habitude de lire, et cela a clairement contribué au fait que j’ai eu du mal à lâcher ce roman !
Excellente découverte, donc, que ce premier tome de la série Les Monstres de papier, qui m’a semblé relever du silkpunk (pour une définition, allez voir là). L’autrice dépeint un univers enchanteur et très visuel, et un système de magie particulièrement original, que j’ai trouvé ici bien exploité. Les péripéties et révélations assurent un rythme très prenant, entretenu par le système narratif judicieusement choisi. Gros point positif : la traditionnelle romance de la fantasy ado a été évacuée (une bénédiction !), au profit d’une solide et belle relation d’amitié que j’ai trouvée très touchante. En bref, voilà un premier tome qui m’a beaucoup plu, et dont j’attends désormais la suite avec impatience !